DIES
ACADEMICUS 1969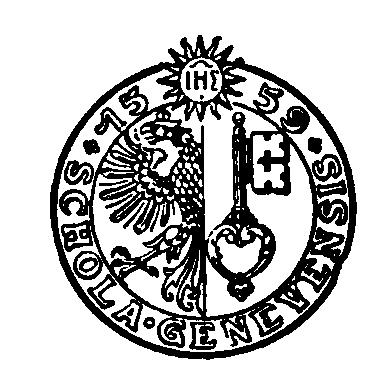
Allocution du
Recteur de l'Université
Au mois de juin 1966, le Sénat de l'Université désignait un recteur et deux vice-recteurs appelés pour la première fois à exercer leur mandat pendant trois ans. Ces trois hommes ont assumé leurs fonctions avec la volonté très consciente de diriger l'Université dans toute la mesure compatible avec les dispositions de la loi sur l'instruction publique. Sans prétendre présenter encore un bilan détaillé de l'expérience, je voudrais évoquer ici les divers types de questions qui nous ont retenus. Pour ne rien omettre d'essentiel, j'ai parcouru les procès-verbaux du bureau du Sénat et constaté à cette occasion que ce rouage, dont on a dit parfois qu'il n'était occupé que de choses futiles, et inapte à l'élaboration de décisions, a bel et bien consacré le principal de ses séances à l'examen des grands problèmes du moment, et constitué pour le recteur le conseil le plus attentif, le plus sûr et le plus éclairé.
Il est caractéristique, je crois, de l'esprit qui nous animait, que la première recommandation émise à l'intention du corps professoral ait tendu à l'observation rigoureuse de la voie du service. Elle manifestait le souci de connaître, de contrôler, et si possible de coordonner dans tous ses détails, le jeu de l'énorme entreprise qu'est devenue l'Université, et d'offrir à ses interlocuteurs du dehors, qu'il s'agisse de l'Etat ou de toute autre institution, un partenaire unique et cohérent. Nous avons eu ainsi l'attention portée, à tour de rôle, et au gré des circonstances, sur presque tous les secteurs de l'Université.
Sur les facultés d'abord, dont le développement nous paraissait singulièrement inégal; en sciences et en médecine, l'essor de la recherche avait entraîné une prolifération de petits instituts à l'activité parallèle et parfois concurrente. En regard de ces deux facultés, aux besoins toujours insatisfaits en dépit d'une dotation croissante en cadres, en locaux et en équipements, les facultés de sciences morales offraient une apparence monolithique et une stabilité qui cachait mal l'insuffisance des moyens de travail. D'emblée, nous fûmes conscients de la nécessité d'une restructuration des facultés permettant aux unes une meilleure utilisation de leurs ressources, et aux autres un rattrapage dont personne aujourd'hui n'oserait mettre l'urgence en doute. Amorcée dès l'automne 1966, l'étude des nouvelles structures devait tendre à coordonner plus étroitement l'effort de recherche et d'enseignement, tant à l'intérieur d'une même faculté qu'entre deux ou plusieurs facultés, mais à aucun moment, nous n'avons songé à supprimer, ou même à affaiblir les facultés traditionnelles, qui offrent à l'Université une armature, un esprit de collégialité et un capital d'expérience dont elle ne pourrait se passer actuellement.
En effet, si des facultés nous passons aux divers instituts rattachés directement à l'Université, nous mesurons aussitôt à quel point leur existence est plus difficile. Nés souvent de l'initiative d'hommes éminents, ou vivant de leur rayonnement, ils s'intègrent mal à la communauté universitaire dont ils alourdissent le poids, et voient leur statut remis sans cesse en question. Institut des sciences de l'éducation,
Ecole d'interprètes, Ecole d'architecture, autant de problèmes, et je dois le dire honnêtement, de problèmes que nous n'avons pas résolus. N'oublions pas la Faculté autonome de théologie, qu'une double allégeance entretient dans une condition médiocre, dont nous souhaitons vivement la voir sortir par une réintégration pure et simple dans l'Université.
Je ne m'arrêterai pas aujourd'hui, encore que le sujet me tienne à coeur, à la question des bibliothèques, sinon pour signaler que le bureau du Sénat vient de créer une commission de coordination dans laquelle plusieurs places ont été réservées aux responsables de la Bibliothèque publique et universitaire et éventuellement d'autres bibliothèques scientifiques de la Ville. Et j'en viens à l'administration centrale de l'Université qui a retenu beaucoup de notre temps. C'est que le volume des affaires à traiter par elle a crû démesurément, non seulement en raison de l'augmentation du nombre des étudiants et des enseignants et de la multiplication des prestations à remplir sur le plan comptable ou dans le domaine social, mais aussi du fait d'une autogestion toujours plus réelle. L'Université assume désormais l'engagement du personnel auxiliaire et des assistants, elle contrôle la totalité de son budget. L'achat par l'Etat d'une calculatrice électronique de grande puissance a permis d'amorcer une mécanisation qui, étudiée de longue date par le secrétaire général et mise en oeuvre par un groupe qu'anime le secrétaire de l'Université, M. Claude Bossy, entraîne une refonte progressive de nos règlements administratifs. Au moment où une redistribution des tâches dans les services centraux de notre maison apparaît inéluctable, je ne saurais manquer de rendre hommage à notre secrétaire général, M. Bernard Ducret, qui, avec les moyens artisanaux et désuets dont il disposait, a fait face avec un minimum d'accidents à des exigences croissantes, et a apporté sa contribution personnelle à une réorganisation dont j'espère qu'elle permettra à mon successeur de se vouer plus complètement à la poursuite des objectifs permanents de l'Université, l'enseignement et la recherche.
A cet égard, nous avons constaté le rôle que joue l'établissement par l'Université de son budget annuel. C'est là que s'exprime la volonté de favoriser en priorité certaines disciplines ou de proposer pour d'autres un effort de rattrapage. Mais cette volonté ne peut avoir d'effet que dans une perspective de plusieurs années. Nous avons donc mis au point, au profit de certains instituts, des budgets quinquennaux, et nous avons eu la satisfaction de retrouver dans les directives émises par le Conseil suisse de la science au sujet de l'Aide fédérale aux universités, la notion de budget à moyen terme (4 ou 5 ans) et à long terme (20 ans). Mais comment se déterminer sur le choix des secteurs préférentiels? Nous avons largement recouru, à cette fin, aux avis du Conseil académique, qui a trouvé là une de ses fonctions essentielles. Nous avons aussi constitué pour des domaines particuliers des groupes de travail réunissant, à côté de professeurs, des spécialistes de l'extérieur. Je pense qu'il en ira de même à l'avenir, mais il incombera à la commission de développement récemment constituée au sein de l'Université de faire la synthèse des rapports et d'en traduire les conclusions dans des budgets à moyen et à long termes. Ces options devraient au surplus être largement conditionnées par le souci d'une planification à l'échelon national, voire international. Mais il faut avouer qu'on ne voit pas encore très bien à quel échelon universitaire ou gouvernemental, et par quel rouage, se prendront les décisions qui engageront nos universités suisses sur la voie d'une coordination efficace.
Ayant parlé de budget, comment n'évoquerais-je pas aussi, en présence des représentants des autorités cantonales, le problème lancinant des locaux nécessaires à notre activité, et des surfaces à réserver en temps utile à l'Université? Tous les calculs qu'on a pu faire sur des données diverses indiquent que le nombre des étudiants aura doublé dans un délai de vingt ans. Bien avant ce terme, des besoins pressants se manifesteront, se manifestent déjà, que ne satisfait pas le programme
des constructions en cours, si onéreux qu'il puisse paraître. Ce programme même risque d'être compromis si, faute d'une décision rapide, l'Université ne pouvait plus s'étendre dans la zone où s'édifient maintenant ses futurs centres et devait émigrer par paquets successifs à la périphérie de la ville.
Il n'appartenait pas à l'Université, mais au Conseil d'Etat, de se prononcer sur ce point, mais sur d'autres points qui n'intéressent que l'Université, je dois bien admettre que les positions que nous avons adoptées ne se sont pas toujours traduites dans les faits. C'est qu'en l'état présent de la législation universitaire, le rectorat n'a aucun pouvoir spécifique. Il n'est qu'un intermédiaire entre les collèges professoraux, constitués par les facultés ou par le Sénat, et l'Etat. Une tradition largement répandue en Europe veut que les premiers décident des règlements et des programmes d'études, le second se réservant la direction générale et le financement de l'Université. Débordé par la poussée de l'après-guerre, cet appareil s'est révélé inapte à la prévision et à la planification. Animés d'un double souci d'indépendance personnelle et d'égalitarisme, les professeurs se prêtent malaisément au choix de priorités et l'Etat de son côté n'est pas outillé pour suivre dans leur complexité les affaires de l'Université. Ainsi en est-on venu un peu partout, et notamment en Suisse, à souhaiter rendre les universités plus autonomes et les doter en même temps d'une direction plus efficace, susceptible d'adapter l'institution aux besoins du pays et de la société. A Genève, la motion adoptée le 28 juin 1968 par un Grand Conseil unanime formule à son premier point le double voeu que «la direction de l'Université soit renforcée» et que «l'autonomie administrative soit assurée».
Mais voici qu'à l'Université même, dont on pouvait croire l'attente satisfaite, les porte-parole des étudiants, des professeurs et de leurs auxiliaires se sont entendus pour demander qu'à côté de ce rectorat «fort» fût constitué un conseil nouveau, où ils seraient tous représentés, et qui prendrait, sur toutes les questions dont il se saisirait, des décisions exécutoires. C'est l'aspect genevois de la crise qui agite les universités sur toute la surface de la planète. On sait qu'elle provient d'une insatisfaction dont on a déjà mainte fois analysé les motifs. Les uns se découvrent dans le fonctionnement de l'Université; on incrimine le contenu et la forme de l'enseignement, on souligne le retard pris par l'institution sur le plan matériel. Mais si ces griefs étaient la cause principale de l'agitation, la crise serait la plus forte dans les universités les plus arriérées. Les nouvelles qui nous viennent de Berkeley, de Harvard ou de Berlin montrent bien qu'il y en a d'autres qui débordent le cadre de l'Université. C'est la société qui est mise en cause et très particulièrement sa structure économique. Crise de conscience d'une jeunesse nantie, qui s'interroge sur la légitimité de sa propre aisance. Ressentant les règles qui nous régissent comme autant de contraintes, elle recourt à la contrainte pour nous les faire abolir. Nous l'observons depuis des mois parmi les étudiants de l'Université de Genève. Selon les individus, la critique s'exprime sur des registres différents, religieux, philosophiques ou politiques. Cohérents dans la condamnation des institutions existantes, ils ne le sont plus du tout dans la conception des structures de rechange. Ainsi s'expliquent les cassures qui disloquent périodiquement leurs groupements, qu'ils s'appellent CADE, ALU ou AGE. Leur inquiétude n'en ébranle pas moins gravement l'Université; elle empoisonne les rapports qu'ils entretiennent avec les professeurs.
A ce climat de défiance dans lequel nous vivons, participent aussi dans une certaine mesure ceux qui ont choisi de s'appeler «Jeunes chercheurs» et que je définirais plus volontiers comme les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche: j'entends par là les chefs de travaux, les chargés de recherches et les assistants. Et je dois reconnaître que si les uns et les autres ont bénéficié d'une substantielle amélioration de leur traitement, par rapport au passé, ils n'ont pas encore reçu un statut qui détermine exactement les conditions de leur emploi, en sorte que
plusieurs d'entre eux se sentent dépendants à l'excès du bon vouloir d'un directeur d'institut. Enfin, même parmi les professeurs, nous trouvons des causes d'insatisfaction. Non plus comme naguère sur le plan de la rémunération, l'effort entrepris par nos prédécesseurs et auquel nous avons encore dû consacrer de nombreuses séances de travail, a abouti le 28 juin 1968 au vote par le Grand Conseil d'une révision très valable des articles de la loi sur l'instruction publique relatifs au statut et au traitement du corps enseignant. Je tiens à rendre hommage aux pouvoirs publics, et très particulièrement au chef du Département de l'instruction publique, pour la largeur d'esprit dont ils ont fait preuve dans l'application des nouvelles dispositions légales. Si malaise il y a, c'est plutôt dans les rapports que détermine une structure encore trop rigide et paralysante. Le titre de professeur extraordinaire, que certains ressentent comme une discrimination, ne devrait être employé, à mon sens, que pendant une période probatoire ou pour des enseignements marginaux. Partout où nous l'avons jugé possible, nous avons préconisé des solutions collégiales; la direction d'un grand département comporte aujourd'hui une besogne administrative qui, lorsqu'elle est assumée par un seul homme, contrarie sa vocation de savant et de maître. Il me faut ajouter que beaucoup de professeurs ont subi, dans une moindre mesure à Genève qu'à l'étranger, mais dans une mesure sensible néanmoins, le choc des événements récents. Ils ont conçu des doutes sur la possibilité de poursuivre leurs activités au sein de l'Université, et leur inquiétude personnelle, s'ajoutant à celle des étudiants, compromet les chances de réussite d'un dialogue pourtant si nécessaire. Comment, dans cette situation, rétablir la confiance?
Un premier moyen est assurément une information permanente et complète. Toute mesure prise de bonne foi par les autorités responsables étant aussitôt interprétée comme une manoeuvre servant quelque dessein inavouable, il importe que les mobiles de nos décisions soient exposés aussi clairement que possible. Mais l'expérience montre que l'information n'arrive jamais assez vite, ou n'arrive pas à ceux qui devraient la recevoir. Je crois donc le moment venu de faire un pas de plus et de rechercher un mode d'association qui permette à tous les membres de la communauté universitaire de participer à l'élaboration des décisions qui les concernent. C'est ce que visent les projets élaborés depuis des mois, tant à Genève que dans les autres cités universitaires de notre pays. Mais il faut bien voir que la consultation préalable de tous les intéressés aura pour effet de ralentir, sinon d'entraver, le mécanisme de la décision et rendra la coordination plus difficile. Cette «démocratisation» va à l'encontre de l'exigence que j'ai motivée tout à l'heure d'une direction plus forte, plus libre dans ses choix, et, pour employer un mot décrié mais pertinent, plus technocratique. Il faut être conscient de cette antinomie. Une solution radicale dans un sens ou dans l'autre est actuellement irréalisable. Les solutions qui s'imposeront seront nécessairement des solutions de compromis. J'y insiste, car à l'heure où va s'ouvrir à l'Université, au Grand Conseil et dans la cité la discussion sur un projet de loi approuvé par le Conseil d'Etat, il importe que chacun mesure exactement les incidences sur nos diverses activités des positions qu'il serait porté à défendre spontanément.
On a pu croire un temps que la réforme de l'Université serait accomplie avant le terme de la présente législature tant universitaire que politique. Il est désormais évident qu'un délai d'une année au moins interviendra avant la promulgation de la nouvelle loi. Ce temps de réflexion sera salutaire si les débats qui l'occuperont témoignent du sang-froid et de l'objectivité nécessaires à l'aboutissement d'une réforme acceptable pour tous les intéressés. Il ne me paraît pas mauvais non plus qu'à l'université, une relève du rectorat permette de dissocier un projet du nom de ceux qui l'ont porté.
Qu'il me soit permis, en terminant, de vous remercier, Monsieur le Président, de la liberté avec laquelle durant ces trois années nous avons pu nous entretenir
de tous les sujets qui ont motivé nos rencontres, et de me féliciter de ce que, dans des moments difficiles, nous ayons pu accorder nos vues avec autant d'aisance.
Que mes collègues sachent l'appui qu'à été pour moi le témoignage sans cesse renouvelé de leur confiance et que les étudiants se persuadent que les meilleurs moments de ma carrière ont toujours été ceux que j'ai passés avec eux pour traiter d'affaires universitaires ou d'histoire ancienne.






